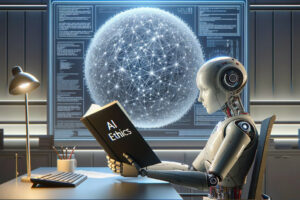Culture et IA: enjeux et tensions
Alors que l’intelligence artificielle transforme en profondeur les modes de création, de diffusion et d’accès aux œuvres, les secteurs culturels européens tirent la sonnette d’alarme. La régulation de l’IA ne peut ignorer la protection des droits d’auteur, la reconnaissance des créateurs et la préservation de la diversité culturelle.
Préserver la Culture face à l’émergence des IA à usage général
Le 7 mai 2025, en amont du Conseil de l’Union européenne dédié à l’Éducation, à la Jeunesse, à la Culture et au Sport, l’Italie, le Portugal et l’Espagne ont lancé un appel solennel : les secteurs culturels et créatifs ne doivent pas rester à la marge des débats sur l’intelligence artificielle à usage général (IAUG). Cette interpellation politique survient alors que l’Union européenne s’engage dans la mise en œuvre du règlement sur l’IA, lequel impose aux fournisseurs d’IAUG des exigences renforcées de transparence, de documentation et de gouvernance.
Au cœur des préoccupations : la nécessité impérieuse de garantir la protection des droits d’auteur et des droits voisins, la transparence sur les données d’entraînement utilisées par les systèmes d’IA, la sécurité juridique via des mécanismes d’identification normalisés et le respect des cadres juridiques européens existants. Les créateurs et titulaires de droits doivent pouvoir s’opposer à l’exploitation automatisée de leurs œuvres, notamment au titre de l’exception dite TDM (Text and Data Mining), conformément à la directive européenne sur le droit d’auteur de 2019. Cette disposition permet aux auteurs de manifester leur refus d’être inclus dans les corpus de données extraits pour l’entraînement des modèles, en réservant expressément leurs droits.
Vers une infrastructure juridique pour l’expression des droits de réserve
Une dynamique s’est enclenchée au niveau européen pour structurer l’expression effective des droits de réserve. Le Bureau européen pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a récemment publié une étude détaillée sur les enjeux du droit d’auteur face à l’IA générative. Ce rapport, qui sera examiné le 12 mai par la commission des affaires juridiques du Parlement européen (JURI), met en lumière l’absence de solution unifiée permettant aux titulaires de droits de s’opposer facilement à l’usage de leurs œuvres dans le cadre des pratiques de fouille de textes et de données.
Le rapport souligne également l’absence d’une norme claire pour identifier et signaler les contenus synthétiques générés par l’IA, tout en constatant que plusieurs accords privés ont déjà vu le jour entre développeurs de modèles et ayants droit. Face à cette fragmentation, l’EUIPO appelle les pouvoirs publics à soutenir la mise en place de bases de données recensant les droits de réserve.
La Commission européenne a aussi franchi une étape en confiant, le 10 février dernier, à un consortium conduit par CapGemini Espagne et Visionary Analytics, une étude de faisabilité pour la création d’un registre centralisé des refus. Ce registre permettrait aux titulaires de droits d’enregistrer, à l’aide d’identifiants d’œuvres et de métadonnées associées, leur opposition à l’usage de leurs créations au titre de l’exemption TDM. L’étude envisage également d’inclure des fonctionnalités facilitant l’octroi de licences dans les cas où une utilisation encadrée serait envisagée.
Le retard du code de bonnes pratiques met en lumière un désalignement transatlantique
Dans ce contexte juridique en mouvement, l’élaboration du code de bonnes pratiques de l’Union européenne sur les IA à usage général (IAUG) constitue un point d’attention majeur. Ce code, prévu par le règlement sur l’IA pour orienter la conformité des fournisseurs d’IAUG, aurait dû être publié au 2 mai. Or, la Commission européenne a annoncé un second report de sa publication, invoquant la complexité de l’alignement avec les lignes directrices récentes et les pressions exercées par les grandes entreprises technologiques, notamment américaines.
Ce retard est symptomatique d’un désalignement stratégique croissant entre l’approche européenne, fondée sur la régulation, la traçabilité et la protection des droits fondamentaux, et l’approche américaine plus permissive, axée sur l’innovation rapide et l’autorégulation sectorielle. À terme, c’est la capacité de l’Union européenne à défendre son modèle culturel et juridique face aux puissances technologiques globales qui se joue.
La défense des créateurs, la reconnaissance des œuvres et la diversité culturelle ne sauraient être sacrifiées sur l’autel de la performance algorithmique. L’Europe doit garantir, avec rigueur et ambition, que l’IA se développe dans le respect des valeurs qui fondent son projet culturel et juridique. L’instauration d’un registre centralisé des refus, la codification de pratiques responsables par les acteurs de l’IA et l’implication pleine et entière des ministres de la Culture dans les négociations sont autant de leviers pour relever ce défi. Le débat ne fait que commencer.
Cet article où j’analyse les arguments juridiques de chaque partie, avant de mettre en lumière la complexité du cadre réglementaire européen et américain, notamment en ce qui concerne le « fair use » et l’exception de « text and data mining » (TDM) introduite par la directive européenne sur le copyright pourrait aussi vous intéresser.
Sources:
- Secretériat Général du Conseil de l’Union européenne, 7 mai 2025, docuement 8188/25, pdf
- European Union, Intellectual Property Office, Study – The development of GenAI from a copyright perspective – FULL report.docx
- EU Funding & Tenders Portal
Étiquette:copyright, droit d'auteur, IA, Règlement IA